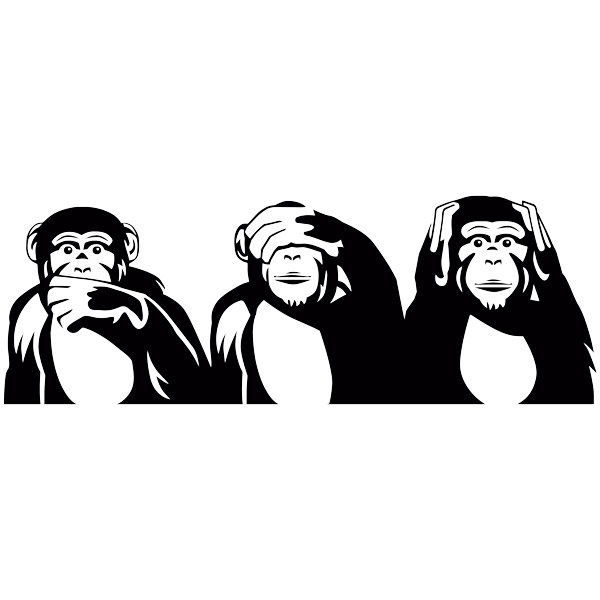-
L’inestimable sororité des mères
Lire l’article : L’inestimable sororité des mèresà Séverine, Shima, Christelle, Stéphanie, Mélanie, Anne-Charlotte et toutes celles qui se reconnaîtront. J’ai toujours compris la valeur de l’amitié. Dans mes jeunes années, ces liens étaient divers et variés, profonds ou superficiels, je l’admets volontiers, parfois même aussi carrément circonstanciels. Cela a changé en donnant la vie. Plus de temps pour le jeu relationnel.…
-
« Oublier Gabriel » par Karine Yoakim Pasquier
Lire l’article : « Oublier Gabriel » par Karine Yoakim PasquierOublier Gabriel c’est choisir de se rappeler. Se souvenir de cette période si particulière de l’adolescence avec ce qu’elle contient d’ambivalent : la force exponentielle indissociable de la violence des sentiments. Les premiers émois si puissants, le désir d’appartenance à un groupe et toutes les thématiques liées à ce dernier : l’effet de masse, le harcèlement, le racisme,…
-
La valeur du lien
Lire l’article : La valeur du lienSi quelque chose frappe en ces temps où la numérisation de la société avance à grands pas, dans cette époque où les contacts doivent être réfléchis, limités, anticipés, organisés, lors de cette période qui impose le masque à tous presque partout, c’est la dangerosité du manque de lien. Nous n’allons pas ici polémiquer sur la…
-
Soyons « Dandy »
Lire l’article : Soyons « Dandy »Dans Le Peintre de la vie Moderne, Baudelaire nous propose un portrait du dandy complet et nuancé. Je vous invite à relire ce bijou de réflexion que je vous propose de vulgariser aujourd’hui. Dans la première partie de son texte, l’auteur nous explique que le dandy qui n’a d’autre métier que celui de se montrer…
-
« Lâcher prise »vs « laisser-aller ». L’équation impossible de la maternité.
Lire l’article : « Lâcher prise »vs « laisser-aller ». L’équation impossible de la maternité.« Elle se laisse aller. » « Elle devrait lâcher prise. » Ces deux injonctions accolées l’une à l’autre semblent complètement impossibles à associer pour une jeune ou moins jeune mère moderne. La voici la fameuse, la très sérieuse injonction paradoxale conjuguée au carré et souvent au féminin. Devenue maman, je reste subjuguée, presque sidérée par la pression qui…
-
Les singes de la sagesse ?
Lire l’article : Les singes de la sagesse ?Mon regard attrape un reflet dans la vitre d’un transport public ; un visage avec des écouteurs sur les oreilles, un masque sur la bouche et des lunettes de soleil sur les yeux. C’est bien de moi dont il s’agit. Plus consciemment mouton que singe, je pense pourtant immédiatement à cette représentation connue. Le sens…
-
Toujours les mèmes
Lire l’article : Toujours les mèmesà nos pères, fans de la théorie mémétique dawkinienne et du mimétisme girardien. Hyper connectés, nous subissons avec une délectation presque écœurante la vague des mèmes. La charge virale que nous participons à gonfler avec un entrain volontaire ou une résignation conscientisée, se révèle bien plus puissante qu’aucun autre gouvernement en place, allant jusqu’à tous…
-
« J’emporterai le feu » ou l’incandescence de l’auto-fiction par le romanesque
Lire l’article : « J’emporterai le feu » ou l’incandescence de l’auto-fiction par le romanesqueLire du Slimani c’est comme boire une liqueur dont l’effet viendra vous envahir quelque temps après ingestion pour vous surprendre progressivement, en délicatesse, venir imposer une torpeur particulière suscitée par des associations improbables. Lire du Slimani ce n’est pas s’accorder une lecture dite « facile », une lecture « plaisir », non. Lire du Slimani c’est accepter d’être dérangés,…
-
« Inside-Out »
Lire l’article : « Inside-Out »On a le choix du non choix. On est dedans mais on peut toujours opter de river ses yeux sur la porte fermée, sa poignée soigneusement évitée, désinfectée à outrance par des mains rêches d’être trop lavées, ou bien regarder par la fenêtre. Une question de prisme toujours, de perspective. Une pièce sans porte, et…
Réflexions quotidiennes
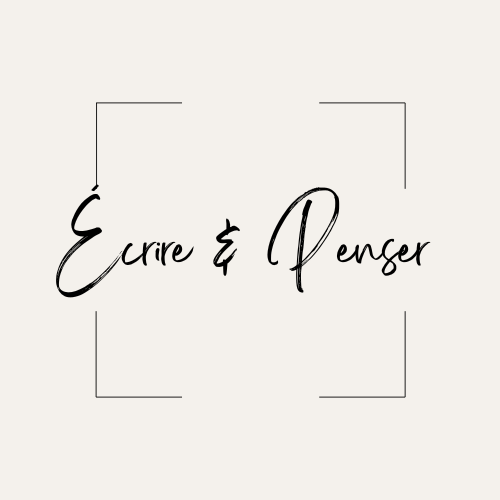
La passion d’écrire
Lisez mes derniers articles !
Articles
About the Author
Zenia Boulat
Je m’appelle Zenia, passionnée par les mots et leur pouvoir de transmission. Mes origines suisses, françaises, russes et espagnoles enrichissent mon regard sur le monde et ma sensibilité. Installée sur la Riviera, j’y puise l’inspiration pour écrire et partager le goût des textes qui résonnent à travers le temps. Maman et enseignante, j’essaie d’offrir des réflexions qui invitent à questionner un quotidien souvent tourmenté. La lecture et l’écriture sont, pour moi, des chemins vers une meilleure compréhension de soi et des autres.